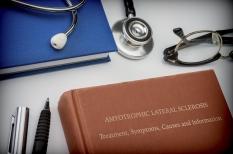- Le congrès "Paris Santé Femmes" s'est clôturé par un symposium réunissant gynécologue, sexologue, psychologue et conseillère conjugale sur un thème encore tabou : le désir féminin.
- Touchant plus les femmes que les hommes, le désir sexuel hypoactif se caractérise par une perte de désir, entrainant une détresse personnelle, envers son ou sa conjoint(e).
- Les causes sont multiples et l'impact sur la qualité de vie est significatif, entrainant des sentiments de frustration, de stress, de culpabilité ou encore de faible estime de soi.
Ce trouble mental concerne à la fois les femmes et les hommes et peut avoir de multiples causes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou relationnelles. “Les désirs sexuels hypoactifs féminins sont une plainte fréquente en sexologie clinique qui, statistiquement, touche plus les femmes que les hommes”, détaille Laury Phomma Vanden Wildenberg, psychologue à Roubaix.
Les facteurs du TDSH sont multiples
Sur le plan physique, des déséquilibres hormonaux, des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques, ainsi que les effets secondaires de certains médicaments, peuvent réduire le désir sexuel. Psychologiquement, des conditions comme la dépression, l'anxiété, le stress et les expériences traumatiques, peuvent jouer un rôle crucial. Les relations et la qualité de la communication entre partenaires sont également essentielles : des conflits, un manque de compatibilité sexuelle ou une mauvaise communication peuvent exacerber le TDSH.
“Il y a des facilitateurs et des inhibiteurs comme les pathologies sous-jacentes qui induisent un dérèglement hormonal. La prolactine lors de l’allaitement est un peu l’hormone anti-désir. Il y a aussi le rapport à notre corps et aux autres, comment est-ce que l’on s’appelle au sein du couple, l’état du couple et sa communication. Et cela va de sens, mais la violence au sein du couple, qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle, ne rend également pas propice à un désir sexuel. Il y a également certaines périodes de la vie, les facteurs de stress, le quotidien professionnel, qui peuvent avoir un effet sur notre disponibilité psychique”, confirme la psychologue roubaisienne.
Les femmes en majorité plus impliquées dans ce trouble que les hommes
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette disparité : “Le désir féminin évolue au fil du temps de la vie d’une femme : la puberté, la grossesse, le post-partum, la ménopause”, explique Laury Phomma. De plus, les attentes sociales et culturelles peuvent également jouer un rôle, avec des pressions souvent plus fortes sur les femmes concernant leur sexualité et leur rôle dans le couple. Les femmes sont également plus susceptibles de subir des traumatismes sexuels, ce qui peut avoir des effets réels sur leur désir sexuel. En outre, la charge mentale et émotionnelle liée aux différentes responsabilités personnelles, familiales et/ou professionnelles peut, en grande partie, participer à une diminution du désir sexuel chez les femmes.
L’anti-désir par excellence : la dette sexuelle
L’idée de "dette sexuelle" illustre bien les dynamiques complexes autour du désir sexuel féminin et du TDSH. Ce concept de dette sexuelle se réfère à la perception ou à la pression selon laquelle une personne, souvent une femme, se sent obligée de participer à des activités sexuelles pour répondre aux attentes de son partenaire ou pour "rembourser" des faveurs ou des attentions : “C’est le fait de se sentir obligé d’avoir un rapport sexuel après s’être fait offrir un ciné ou un resto par exemple. 53 % des femmes, de tous genres et toutes orientations confondues, ont déjà accepté d’avoir une relation sexuelle sans consentement ou sans désir”, vulgarise, au congrès Paris Santé Femmes, la psychologue.
Cela peut être vécu comme une obligation, aggravant le TDSH. En comprenant ces dynamiques, on met en lumière l'importance de la communication et du consentement mutuel dans les relations sexuelles : “Le désir chez l’homme et la femme est multifactoriel. Sauf que chez l’homme, il y a un moteur qui est très puissant qui est la testostérone en quantité suffisante pour induire chez lui un désir pulsionnel. La femme n’a pas ce moteur hormonal et on dit classiquement que le désir sexuel féminin est plutôt contextuel, qu'il répond à un cadre et une ambiance”, intervient le Dr Samuel Salama, gynécologue obstétricien et sexologue à l’hôpital américain de Paris.
Les femmes, souvent plus sujettes à cette pression de "dette sexuelle", peuvent ressentir une diminution de leur désir sexuel en raison de ces attentes implicites ou explicites : “Il est important d’expliquer et d’expliciter ces mécanismes. C’est la rencontre de deux modes de fonctionnement différents et il faut connaître les codes de l’un et les codes de l’autre pour que cela puisse fonctionner et permettre de ne pas rester sur de fausses idées. L'homme désire la femme, la femme désire le désir de l’homme.”